Une analyse de l'implication française au Rwanda par le général Patrice Sartre
Le général Patrice Sartre, ancien de l'opération Turquoise au Rwanda, publie un article intitulé "La décision politique dans les engagements militaires de la France" qui a retenu mon attention.
Dans un article publié dans le journal Le Monde en mars 2021, frappant par sa lucidité et son honnêteté, le général Patrice Sartre concluait ainsi :
- "Les responsables politiques et
militaires qui nous ont poussés, et continuent de nous inciter, à
défendre ce qui fut leur politique, nous sont plus odieux que ne sont
injustes ceux qui nous accusent de complicité de génocide. Une éthique
de la direction politico-militaire des opérations de la France reste à
inventer." 1
Plus récemment, il vient de publier un nouvel article, après deux autres dans une même revue, la revue chrétienne de réflexion fondée par des Jésuites français, la revue ÉTVDES. Il est intitulé :
"La décision politique dans les engagements militaires de la France"2
Il s'agit d'une analyse de la politique française au Rwanda, telle que décrite dans le rapport Duclert3.
"Ancien du Rwanda", alors colonel, il commanda le secteur nord de l'opération Turquoise4. D'après ce que nous avons pu reconstituer dix ans plus tard, son action dans ce secteur commença vraisemblablement à partir du 1 er juillet 1994, date à laquelle les hommes du Commandement des Opérations Spéciales (COS) quittèrent le secteur nord, qu'ils devaient "nettoyer" avant l'arrivée des troupes régulières prévues pour cette zone. Le COS alla ce jour-là de bon matin vers son objectif, le secteur dit "sud", en fait à l'est face au FPR On peut se demander si ce secteur "est", qui n'est pas plus au sud que le secteur ouest, n'a pas été nommé "sud" pour dissimuler une avancée vers l'est, où se trouvait le FPR . C'est donc le colonel Sartre qui géra les suites de ce qu'il appelle "la faillite de Bisesero", événement désastreux qui se déroula dans ce lieu du secteur nord de Turquoise du 24 au 30 juin 1994, en ce qui concerne les autorités françaises, mais en réalité pendant tout le génocide pour les rescapés et quelques 65000 victimes Tutsi5.
Ce texte tranche, par sa hauteur de vue, avec le style "Bob Morane" d'un de ses pairs, celui du secteur Ouest, qui titra sur ses larmes de l'honneur qui nous semblent être des larmes de crocodile rageur5bis.
L'analyse est certes relativement courte pour un si vaste domaine historique, une douzaine de pages. Elle n'aborde pas de nombreuses décisions concernant diverses missions françaises au Rwanda de la période 1990-1994, très contestables au regard du génocide des Tutsi prévisible et prévu, et dont le général Varret a témoigné et écrit sur certaines6. On doit rappeler ici que le rapport Duclert est notamment amputé d'une mission particulièrement grave qui concerne le Centre de Recherche Criminelle et de Documentation (CRCD) dans le vocabulaire français ou le "Fichier central" ou "criminologie" dans le vocabulaire rwandais7. Si elle évoque d'autres missions dans d'autres pays, cette analyse se concentre, par manque d'informations dit l'auteur, surtout sur l'opération Turquoise en période de cohabitation8. Elle met bien en valeur les grandes lignes des mécanismes décisionnels de l’État français qui aboutirent au pire au Rwanda et que le paragraphe suivant synthétise brillamment :
- "Dès 1984, à l’occasion de son voyage à Kigali, le Président français avait clairement indiqué qu’il gérerait personnellement ce dossier à travers sa relation personnelle avec le chef de l’État rwandais. Jusqu’à la cohabitation, il en tiendra son gouvernement pratiquement écarté : le chef de son état-major particulier en gérait les aspects de défense, son conseiller pour les affaires africaines les aspects diplomatiques et de coopération, tandis que le secrétaire général de l’Élysée, presque effacé par le rapport Duclert, coordonnait cette gestion. Les vrais ministres, y compris le Premier ministre et son ministre de la Défense, étaient contraints d’obéir. Cette direction politique centralisée était renforcée par une pression directe de l’Élysée sur certaines unités des forces spéciales, court-circuitant les niveaux stratégiques et de théâtre, et ce jusqu’à l’opération Turquoise, maintenant ces unités dans une défiance envers les Tutsi qui sera une des causes de la faillite de Bisesero."
On doit remarquer au passage le rôle technique du Secrétaire général de l’Élysée, qui articule le politique et le militaire dans cette affaire : [il] "coordonnait cette gestion". La pièce d'articulation sans laquelle tout se bloque, mais qui finalement au regard de l'entreprise concrète apparaît bien petite et transparente "presque effacé[e] par le rapport Duclert", ce qui peut arranger ce responsable élyséen, sous un certain angle, pour diminuer ses responsabilités dans les accusations contre la France au Rwanda. Il aurait pu gripper cette déraison. Il l'a facilitée en fonctionnant "normalement". L'un des aspects de l'intelligence est pourtant l'art de discerner l'anormal, l'inattendu et d'agir en conséquence.
L'ensemble du texte du général Sartre montre le piège systémique d'une entreprise étatique française qui, en l'absence de contrôle, notamment par les institutions démocratiques, gagne en efficacité militaire, mais peut mener au pire, comme au Rwanda, ce pire que la cohabitation semble avoir malgré tout modéré. En quel sens ? L'auteur ne le dit pas vraiment. Il évoque une simple guerre possible de la France avec le FPR sous l'influence des va-t'en guerre de L’Élysée, mais on peut penser que sans cette cohabitation, la France aurait en effet pu faire du Rwanda son "Vietnam", à partir de juillet 1994, taraudée sans doute par une revanche à prendre sur Diên Biên Phu, si j'ose dire.
Nous ne pouvons que souscrire à cette analyse du général Sartre qui confirmera aux antimilitaristes qu'il n'y a pas que des imbéciles dans l'armée, comme chez de timorés politiques face à Mitterrand, qui malgré tout peinent à reconnaitre pleinement les faits, quand ils ne les renient pas comme l'ancien premier ministre Balladur qui s'en tient à son idée des choses et évacue des faits connus et reconnus.
Les autorités françaises ont toujours fait fi du génocide de façon constante, ce qu'a bien compris le général Sartre, et soutenu activement leurs alliés génocidaires. En février 2010 avec la visite de Nicolas Sarkozy à Kigali on a enfin senti que quelque chose avait changé dans la politique de la France vis-à-vis du Rwanda et surtout vis-à-vis du génocide des Tutsi. La politique d'Emmanuel Macron a amplifié cette évolution, lui apportant en plus sa touche personnelle d’empathie pour les victimes et les rescapés. C'était attendu depuis longtemps, même si certains furent déçus par sa demande de pardon indirecte. Cette évolution n'est certainement pas close.
Un texte pas complètement dégagé de la polémique
J'ai trouvé ce texte tellement intéressant, que j'en ai oublié très vite le premier paragraphe de la première partie ... très polémique et même agressif à l'encontre de personnes dont je fais partie. En deuxième lecture je dois me rendre à l'évidence qu'il faut bien répondre à cette polémique ouverte par l'auteur et que j'avais dépassée trop vite, trop habitué à ce genre d'attaques formelles.
- "Les acteurs militaires de la politique de la France ont été couverts d’immondices par le rapport Mucyo, puis passionnément critiqués par nombre d’ONG puisant sans recul dans ce rapport".
Suit un rappel, qui n'est pas tout à fait exact, sur la relation soi-disant unanime par la presse sur le dévouement des militaires de l'opération Turquoise aux victimes du génocide. Il y a eu dévouement aux victimes du choléra reconnu unanimement par la presse quelques semaines plus tard, mais pour les victimes du génocide ce fut beaucoup plus hésitant et laborieux, alors que c'était théoriquement la mission première de Turquoise, même si la résolution 929 de l'ONU, rédigée par la France, est très ambiguë, à la limite du négationnisme, répartissant les victimes potentielles dans deux camps a peu près égaux et invitant à une neutralité entre les parties9. L'auteur parle d'ailleurs de la "faillite de Bisesero" qui exprime bien l'abandon des rescapés de Bisesero par l’armée, et plus particulièrement selon lui par le commandant du COS, le colonel responsable du secteur "Sud", qui est ainsi subtilement envoyé sur les roses. Une vidéo de l'armée publiée sur Médiapart est d'ailleurs particulièrement révélatrice à ce sujet10. Certes l'armée, mise devant le fait accompli par une équipe conduite par le sous-officier Thierry Prungnaud, indigné par l'inaction de son commandement, se porta avec retard au secours des derniers survivants Tutsi de Bisesero. C'est sans doute dans la relation de ce secours tardif que le général Sartre place l'unanimité de la presse. Cet abandon fut mis en exergue dans le Figaro par Patrick de Saint-Exupéry, d'abord très factuellement en 1994, puis de façon beaucoup plus analysée en 1998, ce qui provoqua la mission d'information parlementaire sur le Rwanda. Nous ne rappellerons pas les nombreux articles parus en France et en Belgique à ce sujet qui relativisent cette affirmation.
On est mal parti sur la question du refus de la polémique si on ne respecte pas la chronologie des faits.
Rappelons d'abord que la commission rwandaise sur l'intervention de la France au Rwanda, la commission Mucyo, fut décidée par le gouvernement rwandais début août 2004, après une rencontre entre Michel Barnier et son homologue rwandais en juillet 2004 en Afrique du Sud11. Son rapport, daté de 2007, fut publié en août 2008. Ce rapport Mucyo n'est pas passionnel, sa rédaction est de très bonne tenue12, et relève de nombreux points vérifiables dont plusieurs furent déjà soulevés par des ONG à partir de janvier 1993 et donc 15 mois avant le génocide12bis et 15 ans avant la publication de ce rapport. Elles n'ont donc pas "puisé sans recul" dans le rapport Mucyo, même si elles y trouvèrent des compléments que seuls des Rwandais eurent la liberté et la possibilité de signaler. La parole des Rwandais est essentielle dans cette histoire. Que diraient les Français, si on ne tenait pas compte de ce dont ils furent témoins dans des événements qui se seraient déroulés en France ?
Rappelons les principales étapes de la remise en cause de la politique française au Rwanda depuis 1993 et donc pendant 15 ans avant le rapport Mucyo. L'interview de Jean Carbonare par Bruno Masure sur Antenne 2 date de janvier 199312 bis, celle du docteur Jean-Hervé Bradol par Patrick Poivre d’Arvor sur TF1 date du 16 mai 199413, les premiers articles de Patrick de Saint-Exupéry sur l'opération Turquoise dans Le Figaro datent de juin-juillet 199414, le livre de Fançois-Xavier Verschave, Complicité de génocide, date de novembre 199415, la plupart des rapports de diverses institutions et ONG furent publiés entre 1995 et 2000. Plusieurs de ces rapports abordent de façon critique le rôle de la France, notamment ceux de HRW/FIDH Aucun témoin ne doit survivre16 et de l'OUA Le génocide qu'on aurait pu stopper17, voire certains passages du rapport du sénat belge de 199718, et de façon collatérale le rapport de nos députés en 199819, notamment à travers ses annexes et auditions. Les quatre livres, notamment Un génocide secret d’État et La Nuit Rwandaise de Jean-Paul Gouteux datent de 1999 à 200220, le livre du général Dallaire J'ai serré la main du diable date de 200321, le livre de Patrick de Saint-Exupéry L'inavouable - la France au Rwanda22, la commission d'enquête citoyenne (les associations Survie, la Cimade, l'Obsarm, Aircrige et diverses personnalités, juristes, médecins et historiens)23 datent de mars 2004, le film Tuez-les-tous par des élèves de science Po, dénonçant la France au Rwanda24, date de novembre 2004, le rapport de cette commission d'enquête citoyenne25 date de février 2005, présenté simultanément avec les premières plaintes de Rwandais contre l’armée française26, dont trois plaintes pour viols de femmes Tutsi du camp de Nyarushishsi, secteur Ouest de Turquoise et 6 plaintes pour complicité dans le génocide pendant l'opération Turquoise, notamment à Bisesero. Enfin, le témoignage radical d'un acteur essentiel de Bisesero, le sous-officier Thierry Prungnaud, en avril 2005 sur France Culture et dans Le Point qui rusa avec son équipe pour mettre le staff de Turquoise devant les rescapés de Bisesero, puis rompit le silence de la grande muette27. Boubacar Boris Diop fit d'excellents rappels chronologiques dans un article sur le rapport Duclert28.
C'en était trop pour l’État français. Ainsi débarquèrent le livre négationniste de Pierre Péan en novembre 200529, roulant dans la boue des personnalités de l'association Survie et des journalistes. Puis tomba l'ordonnance Bruguière fin 200630, remise complètement en cause par ses successeurs, elle apparaît aussi de nature négationniste, attribuant la responsabilité du génocide aux Tutsi, pour tenter de rétablir "l'honneur de la France" avec de grosses ficelles pour de grosses légumes qui se prennent pour la France outragée. Derrière ce retour de bâton, on devine l'ombre du général Secrétaire de l’Élysée qui continue de "coordonner" ce révisionnisme politique et militaire que les "jeunes" journalistes, Judi Rever et Charles Onana, sont chargés de continuer. Ils écrivent des légendes sataniques de guerre, dévorées par les négationnistes français, les génocidaires rwandais et d'ambitieux Congolais nostalgiques de l'époque Mobutu et revanchards encore trop nombreux qui veulent anéantir le Rwanda31. Bref une réponse qui encourage la guerre dans l'Afrique des Grands Lacs au profit des négationnistes de l'implication de la France dans le génocide des Tutsi et des génocidaires. Cela aura probablement un jour ou l'autre des conséquences dramatiques, dont des Français auront une grande part de responsabilités32.
Ce passage à propos du rapport Mucyo dans l'article du général Sartre apparaît donc comme une figure de style malheureuse placée là, sur le dos des Rwandais, sans fondement, probablement pour rassurer la sensibilité exacerbée de certains lecteurs français, peut-être suite à son article dans Le Monde de mars 2021 et notamment le passage que j'ai cité au début, et bien faire sentir que les critiques qu'il propose sont inspirées par les seules réflexions franco-françaises de son rédacteur, et non pas par des accointances "odieuses". De ce point de vue, il ne se dégage pas complètement de la polémique, mais sur son sujet, "La décision politique dans les engagements militaires de la France", il reste particulièrement pertinent.
Quelles sont les "immondices" dont il accable le rapport Mucyo ? Il ne le précise pas. Apparemment lors de sa dernière visite à Paris, le 18 mai 2021, le Président Kagame invita quelques généraux français "modérateurs". La rencontre se déroula de façon cordiale. Le général Sartre avait décliné l'invitation de Paul Kagame "pour raison de santé" comptant sur son adjoint de l'époque, devenu général, pour représenter son régiment selon le journaliste Jean-François Dupaquier33. Cela renforce l'idée que cette phrase est une figure de style facile dont il n'a pas mesuré la portée.
Les militaires, comme certains juristes, journalistes et historiens, ont beaucoup de mal à admettre que de simples citoyens se soient mêlés aussi profondément de leurs affaires et leur rappellent ainsi ce que signifie l'expression galvaudée par nos institutions : "au nom du peuple français". Ils n'en loupent pas une pour leur boucler le bec et rabaisser les militants d'ONG à leur place "d'amateurs", y compris à travers des décisions de justice odieuses. Je suis un de ces amateurs, et pour de bons français imprégnés de la culture de "l'honnête homme" du siècle dont le "Lagarde et Michard"34 eut des accents dithyrambiques, devant lesquelles la propagande soviétique fait piètre figure, cette phrase du général Sartre sur le rapport Mucyo et les militants d'ONG nous discrimine injustement. Il semble pourtant que notre constance et notre détermination, nos travaux de recherche honnêtes et sincèrement bénévoles, malgré notre "amateurisme" pour certains d'entre nous dont moi-même, aient forcé in fine, sans doute à travers des "conversions" plus illustres, le Président Macron à créer la commission Duclert, malgré le professionnalisme de militaires, de journalistes, de juristes et de politiques pervertis, voire d'historiens militaires, qui travaillaient à enterrer cette affaire monstrueuse.
D'autre part cette phrase sur le rapport Mucyo illustre aussi que, comme souvent en France, les Rwandais sont rejetés comme la cinquième roue de la charrette, après avoir été en ce qui concerne les Tutsi une "cinquième colonne" pour la politique franco-rwandaise. Ces événements se sont déroulés sur leur sol, au milieu de leur peuple, ils en furent témoins directs et même victimes quand ils n'étaient pas les alliés des Français. Les Rwandais disposent de documents significatifs, rédigés par des officiers français, sur du papier à en-tête des institutions rwandaises qu'ils servaient, et qui en vertu de l'accord d'assistance pour la formation de la gendarmerie rwandaise de 1975, amendé à deux reprises en 1983 et 1992, étaient gradés et insérés dans la hiérarchie militaire rwandaise et portaient l'uniforme rwandais35.
On peut aussi considérer que les alliés de la France furent finalement aussi victimes de notre politique, car ils ont échoué sur toute la ligne malgré l'appui renforcé de la France qui les a illusionnés. Ils n'ont réussi qu'une seule chose : exterminer un million de civils Tutsi. Absurde et sanguinaire "compensation". Ce que la France connaissait d'avance et contre lequel, elle n'a jamais levé le moindre petit doigt, sauf l'encouragement, illusoire et contourné, à mettre en retraite deux chefs d’État-major ayant exprimé le projet génocidaire des durs du régime devant les autorités françaises dès 1990. Ils reprirent du service dès le premier jour du génocide, aiguillonnant un gouvernement génocidaire formé à l'ambassade de France. Un comble.
Les vrais "amateurs" de cette histoire lamentable sont ceux qui n'ont pas pris assez de recul devant la propagande des génocidaires et leurs doubles jeux. On retrouve trop souvent les éléments de langage des génocidaires sous des plumes professionnelles françaises, civiles, politiques et militaires.
Une grande partie de la gendarmerie rwandaise, formée par la gendarmerie française pendant 19 ans35, apporta au génocide son bras armé par la France, véhiculé par la France, informatisé par la France. Un des officiers français qui s'occupa de cette formation-équipement osa dire à un journaliste du journal Populaire du centre en 1996, en parlant du Rwanda, que ce pays "n'est pas sanguinaire". D'une certaine manière il a raison, on l'a rendu sanguinaire à travers une propagande que cet officier, resté trois ans au Rwanda de 1990 à 1993, a reconnue très tardivement du bout de son stylo, rongé par le stress d'être accusé, dans ce club de Médiapart. Que ne l'a-t-il pas dénoncée en son temps ! Il ne rappela même pas le génocide des Tutsi, deux ans après en 1996, au journaliste de Haute-Vienne qui l’interviewait, dépeignant les Tutsi comme des êtres maléfiques "avides de pouvoir". C'est du moins ce que le journaliste a compris et rédigé sans doute fidèlement dans le Populaire du centre36. Visiblement cet officier français supporte très mal la victoire politique et militaire du FPR et montre beaucoup d'empathie pour les Hutu. Victoire au goût très amer pour les Tutsi.
Le déni est un refuge psychologique. Académiquement, je ne devrais pas me perdre dans les prolongements des "décisions politiques dans les engagements militaires de la France" ... répercutées par des subalternes trop bêtement zélés et trop en osmose sur le terrain avec les alliés. Ce sont des "détails "pour le général Secrétaire37, mais des détails qui facilitèrent les tueries et qu'il refuse qu'on les évoque, car, comme pour l'ancien premier ministre de cohabitation, cela ne fait pas partie de l'idée qu'il veut donner de l'action de la France au Rwanda : celle qui le mettrait en valeur. Tout cela est très narcissique. Mais que pèse ce narcissisme de responsables Français face à des centaines de milliers de familles, dont je fais partie par alliance, détruites, défoncées, exterminées par une déraison franco-rwandaise ?
Ma conclusion est simple : malgré ces alluvions polémiques induites par une petite phrase malheureuse, le général Patrice Sartre est digne d'être lu et pris en compte, en espérant qu'à l'avenir il respecte mieux les Rwandais et leurs amis dans ses écrits. Cet écart montre que sa réflexion est purement dictée par des repères internes à l'armée, armée qu'il analyse lucidement par ailleurs, compte tenu de ce que nous savons. Certes dans nos analyses nous ne faisons sans doute pas assez la différence entre l’état-major et sa grande muette. Nous les prenons en bloc trop souvent et d'une certaine manière nous faisons ainsi le jeu de l’État-major38.
Mais avant tout cela il y a des survivants qui souffrent encore des comportements que le général Sartre décrit, même s'il comprend bien les grandes lignes du génocide des Tutsi, oublié dans la stratégie française. Cela doit être rappelé à un rédacteur d'une revue chrétienne. On ne peut pas avoir raison sur le dos des Rwandais dans cette affaire.
_____________________________
- Le Monde 30 mars 2021 - Tribune Général Patrice Sartre sur le Rwanda : « Le rapport Duclert rend justice aux soldats de l’opération Turquoise »
- La décision politique dans les engagements militaires de la France - Études n° 4288 - décembre 2021 - On peut consulter ce texte sur le site France génocide Tutsi, et lire avec intérêt le commentaire de présentation de l'article qui relève que ce que dit le général Patrice Sartre est de nature à relancer l'instruction juridique des plaintes de Rwandais concernant Bisesero.
- Le rapport Duclert est le résultat de la décision d'Emmanuel Macron de créer en 2019 une commission d'historiens pour "éplucher" les archives françaises, civiles et militaires. Cet examen ne fut pas exhaustif car certains fonds ne furent pas accessibles, en quelques mois il est difficile à des non spécialistes du génocide des Tutsi, même historiens, de tout embrasser. Enfin l'objet même de cette commission ne lui permettait pas d'avoir un regard synthétique sur les sources d'informations internationales et notamment rwandaises.
- L'opération Turquoise est une opération militaire française au Rwanda menée en vertu de la résolution 929 du Conseil de sécurité des nations unies. Elle se déroula à la fin du génocide des Tutsi (juillet 1994) du 22 juin au 22 août 1994 dans la partie sud-ouest du Rwanda à la frontière avec le Zaïre. Son nom, Turquoise, illustre bien les critiques dont elle est l'objet : c'est celui d'une jolie couleur peut-être choisie pour embellir les choses, mais dont la phonie évoque la Turquie et son inaltérable négationnisme du génocide des Arméniens.
- Bisesero dans le contexte de l'Opération Turquoise
bis :HOGARD Jacques, Les larmes de l'honneur, Hugo doc, octobre 2005 - VARRET Jean, Général, j’en ai pris pour mon grade, Editions Sydney Laurent, Paris, 2018
- Le CRCD, Centre de Recherche Criminelle et de Documentation, désigne le fichier central de l'état-major de la gendarmerie rwandaise à partir du deuxième semestre de 1992. C'est la coopération française qui a souhaité ce changement de nom. Mais il semble que les Rwandais aient conservé dans leur usage les termes de "Fichier central" ou "criminologie". Le "Fichier central" était situé dans un bâtiment du même nom qui avait très mauvaise réputation parmi les Tutsi et les organisations des Droits de l'Homme. Ce fichier était constitué de quatre ou cinq fichiers, dont le fichier PRAS, Personnes à Rechercher et A Surveiller. Ce fichier était constitué de "fiches carton" que la gendarmerie française a informatisées en 1992. Pour comprendre toute l'implication de cette informatisation, lire : Rwanda : les circonspections françaises oublieuses et inconséquentes
- En mars 1993, les élections législatives françaises ont donné la majorité à la droite, apportant Edouard Balladur comme Premier ministre. Le président socialiste François Mitterrand dû donc accepter une "cohabitation" politique. Bien que les questions militaires soient le "domaine réservé" du Président, le ministère de la défense interférait aussi dans ce domaine et Edouard Balladur apparut comme un élément modérateur face aux "va-t'en guerre" de l’Élysée. Toutefois Edouard Balladur ne démord pas de son refus que l'on perçoive la politique française au Rwanda autrement que ce qu'il avait imaginé faire. D'où ses positions très rigides et controversées.
- cf. Note 5
- Génocide des Tutsis au Rwanda: la vidéo qui accable l’armée française Article de Médiapart 25 octobre 2018
- Michel Barnier appela de ses vœux en juillet 2004 (AFP 28 juillet 2004) la création d'un travail de mémoire commun avec le Rwanda. Le Rwanda annonça en août 2004 (AFP 2 août 2004) son intention de créer sa propre commission, qui deviendra la commission Mucyo. Ces intentions exprimées suivirent une rencontre entre les ministres français et rwandais des affaires étrangères en Afrique du sud en juillet 2004.
- Rapport de la Commission nationale indépendante chargée de rassembler les preuves montrant l'implication de l'État français dans le génocide perpétré au Rwanda en 1994, dit Rapport Mucyo,
bis : Regarder notamment la vidéo de l'interview de Jean Carbonare en janvier 1993 - Jean Hervé Bradol sur Europe 1, des éléments de l'interview de JHB de 1994 par Patrick Poivre d'Arvor sur TF1 sont repris dans cette émission.
- Patrick de Saint-Exupéry Recherche sur le site francegénocideTutsi.org
- VERSCHAVE François-Xavier, Complicité de génocide ? La politique de la France au Rwanda, Paris, La Découverte, 1994, 175 p. réédité en 2014
- DES FORGES Alison, Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, Human Rights Watch/FIDH, Karthala, 1999
- Rapport de l'OUA : "Rwanda : le génocide qu'on aurait pu stopper" Notamment le chapitre 12 et suivants
- Rapport du Sénat Belge - On y trouve notamment le témoignage du rapporteur spécial de la commission des Droits de l'homme de l'ONU qui, pour enquêter sur l'attentat du 6 avril 1994 contre les présidents rwandais et burundais, s'est heurté au renvoi mutuel entre les armées françaises et rwandaises . Rapport du Sénat Belge, chapitre 3, paragraphe 5 Les événements des 6 et 7 avril 1994.
- Rapport de la Mission d'information parlementaire française sur le Rwanda 1998- Ce rapport est de valeur très inégale. On y trouve une mine d'informations, des incohérences dans le texte, des annexes et des auditions révélatrices, des faits soigneusement contournés.
- GOUTEUX Jean-Paul, Un génocide secret d'État - La France et le Rwanda, 1990-1997, Éditions sociales, 1998.
GOUTEUX Jean-Paul, Le Monde, un contre-pouvoir ? Désinformation et manipulation sur le génocide rwandais, L'esprit frappeur, 1999
GOUTEUX Jean-Paul, La nuit rwandaise. L'implication française dans le dernier génocide du siècle, L'esprit frappeur, 2002, 637 p.
GOUTEUX Jean-Paul, Un génocide sans importance : la Françafrique au Rwanda, Lyon, Tahin Party, 2001. - DALLAIRE Roméo (Lieutenant-général), J'ai serré la main du diable. La faillite de l'humanité au Rwanda, Libre expression, 2003
- de SAINT-EXUPERY Patrick, L'inavouable. la France au Rwanda, Les arènes, 2004
- Les journées de mars 2004 de la commission d'enquête citoyenne
- Tuez-les tous : Rwanda, histoire d'un génocide "sans importance" documentaire de Raphaël Glucksmann, David Hazan et Pierre Mézerette 2004
- COMMISSION D'ENQUETE CITOYENNE (Rapport) Coret Laure & Verschave François-Xavier, L'horreur qui nous prend au visage, Karthala, 2005
- Les plaintes de Rwandais devant la justice française
- Thierry Prungnaud sur Wikipédia
Transcription de son interview par Laure de Vulpian en avril 2005 sur France Culture - Boubacar Boris Diop a publié sur un site sénégalais un excellent article sur cette histoire de la remise en cause de la politique française : La France et le génocide des tutsi, réflexions sur le rapport Duclert
- PEAN Pierre, Noires fureurs, blancs menteurs, Mille et une nuits, novembre 2005
- L'ordonnance du juge Bruguière comme objet négationniste Rafaëlle Maison, Géraud de Geouffre de La Pradelle Dans Cités 2014/1 (n° 57), pages 79 à 90
- Citer ces deux auteurs, serait citer Pierre Péan pour le Rwanda.
- Trop de Congolais veulent anéantir le Rwanda
- A Paris, d’émouvantes retrouvailles entre Paul Kagame et des officiers supérieurs français ayant servi au Rwanda Afrikarabia
"Presque trente ans plus tard, le chef de l’Etat rwandais garde un bon souvenir de plusieurs interlocuteurs français, l’ambassadeur Yannick Gérard, avec qui il avait eu de longues discussions, et le lieutenant-colonel de Stabenrath, devenu général. En visite à Paris ce début de semaine pour participer à deux sommets, l’un sur le Soudan et l’autre sur les économies africaines, Paul Kagame a demandé à les rencontrer, ainsi que d’autres ex-officiers supérieurs français dont il a appris le rôle modérateur au Rwanda. Sollicité, le général Patrice Sartre a décliné la rencontre en raison de problèmes de santé. « De Stabenrath représentera le régiment », nous a-t-il confié voici quelques jours. Charismatique et très apprécié de ses collègues, l’ex-adjoint de Sartre est aussi un ami du journaliste Jean Hatzfeld, rencontré à Sarajevo et dont il dit avoir dévoré les livres sur le Rwanda. Hatzfeld en a dressé autrefois un portrait flatteur dans Libération : « Erik [Eric] de Stabenrath, descendant d’un général d’Empire, petit-fils de deux militaires et fils d’un officier mort à Dien Bien Phu, sourit en disant qu’il est entré dans l’armée « parce qu’il devinait être fait pour cela » ». Des traits de caractère et une biographie qui semblent avoir plu à l’ancien chef rebelle. " La France est auto-proclamatrice de sa "grandeur". Qu'est-ce que la "grandeur de la France"? Selon moi, c'est la nostalgie du XVII ème siècle telle que présentée par le "Lagarde et Michard", collection, symbole, de manuels de littérature française des lycées et collèges par lesquels la majorité des élites françaises actuelles fut formatée à notre culture. Que dit ce manuel en introduction de ce XVII ème siècle ?
"Le XVII ème siècle français se place sous le signe de la grandeur. C'est le siècle où par l'éclat des lettres et des arts autant que par les armes, la France domine l'Europe".(Lagarde et Michard, édition du 4 ème trimestre 1967)Dans ce manuel, les superlatifs pleuvent à chaque phrase : "éclatante époque", "majestueuse" époque, "années glorieuses du règne de Louis XIV". Bref le culte de notre culture et de sa domination ne peut guère être porté plus à son paroxysme. Les communistes et les autocrates de tous les pays n'ont rien inventé ensuite en matière d'autopromotion.
- La coopération française pour la formation de la gendarmerie rwandaise fut marquée par un "Accord particulier d'assistance militaire", ayant été modifié par deux avenants : un en 1983 et un en 1992. La CEC a analysé ces accords dans ce document de Georges Kapler
- Le Populaire du centre
: une preuve de l'engagement "pro-hutu" d'un officier français, au
mépris de l'évocation du génocide des Tutsi deux ans après le génocide.
Le journaliste, soit abusé, soit de connivence, ose appeler cela un décryptage du conflit Rwandais. Comme
décryptage il y a plus honnête ! Les Français ne se rendent pas compte à
quel point la presse régionale est instrumentalisée par la propagande
française. Toutefois une question se pose devant cette coupure de presse
qui nous a été communiquée : est-ce que l'article est complet.
Quelqu'un de Limoges pourrait-il nous confirmer que cet article est
complet ? En tous cas je peux vous assurer que ce lieutenant-colonel à
qui j'ai communiqué l'article dans le cadre d'un procès n'a jamais fait
valoir pour se justifier que l'article aurait été tronqué.
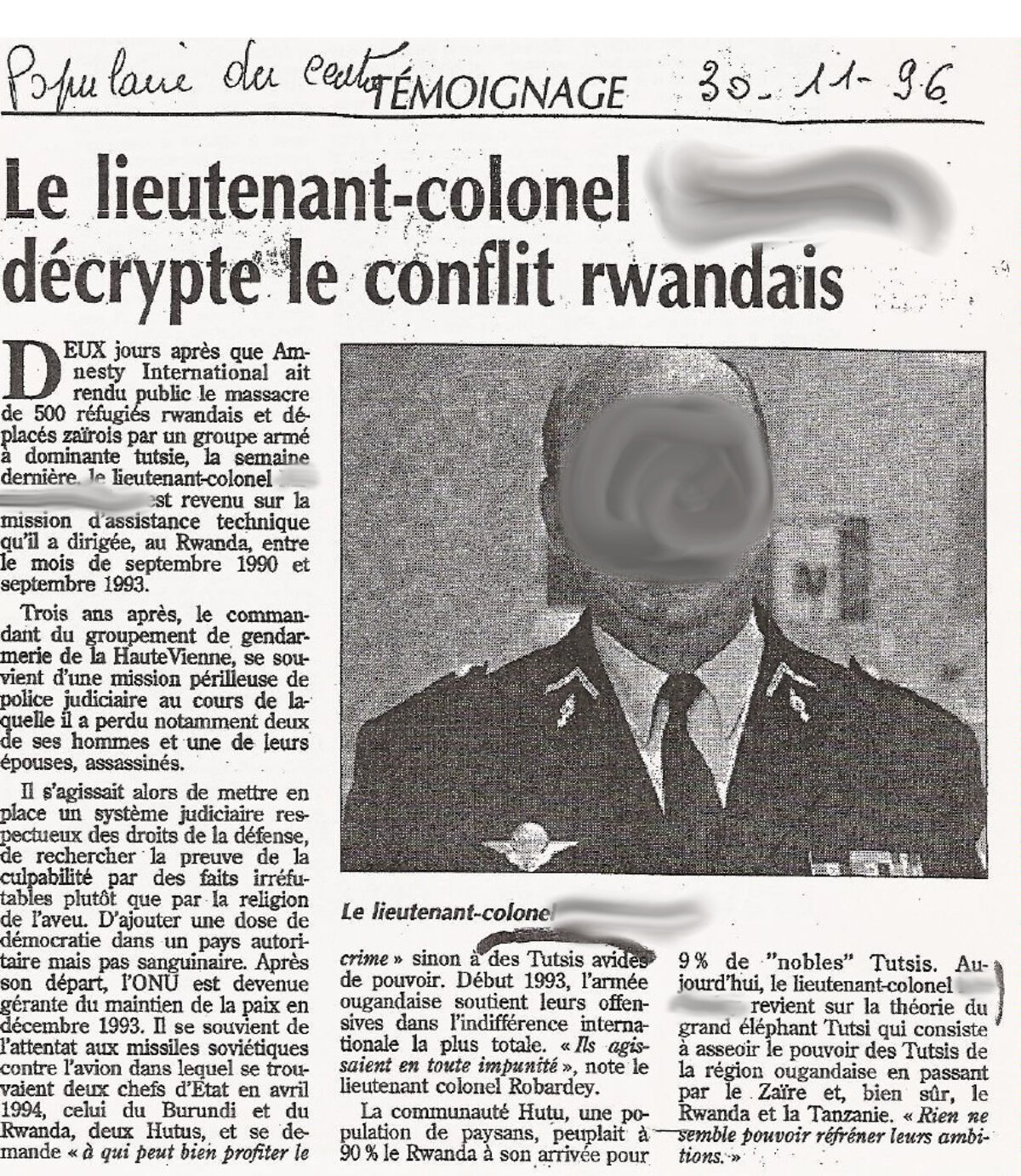
Le Populaire du Centre du 30 novembre 1996 - Soutien aux génocidaires rwandais, H.Védrine a aussi ses "détails" de l'histoire
- Le
lieutenant-colonel Guillaume Ancel lance de vibrants plaidoyers sur son
blog pour modifier la culture mutique de la Grande Muette :
De la culture du silence (ép 1) Raconter la réalité, c’est trahir ?
Commentaires
Enregistrer un commentaire
Écrivez ici votre commentaire qui sera en attente de modération. Les commentaires franchement négationnistes, diffamateurs ou injurieux seront rejetés.